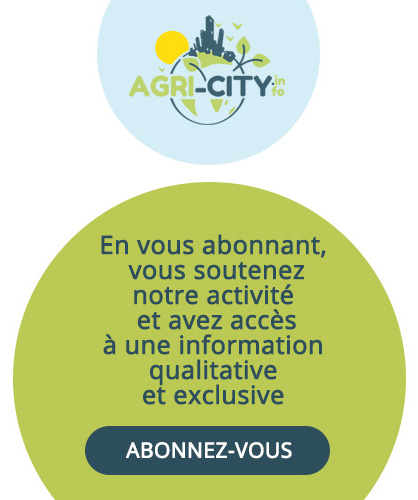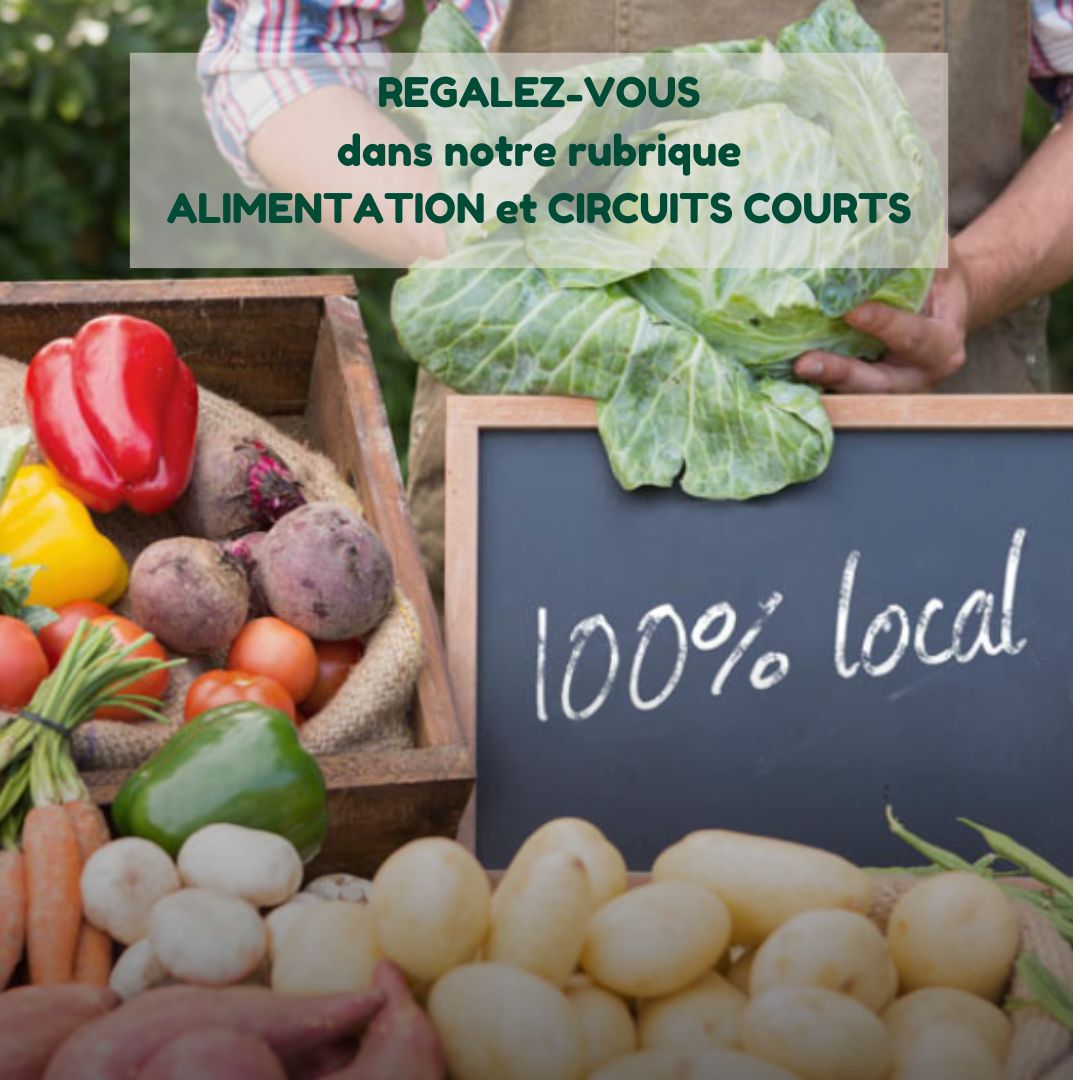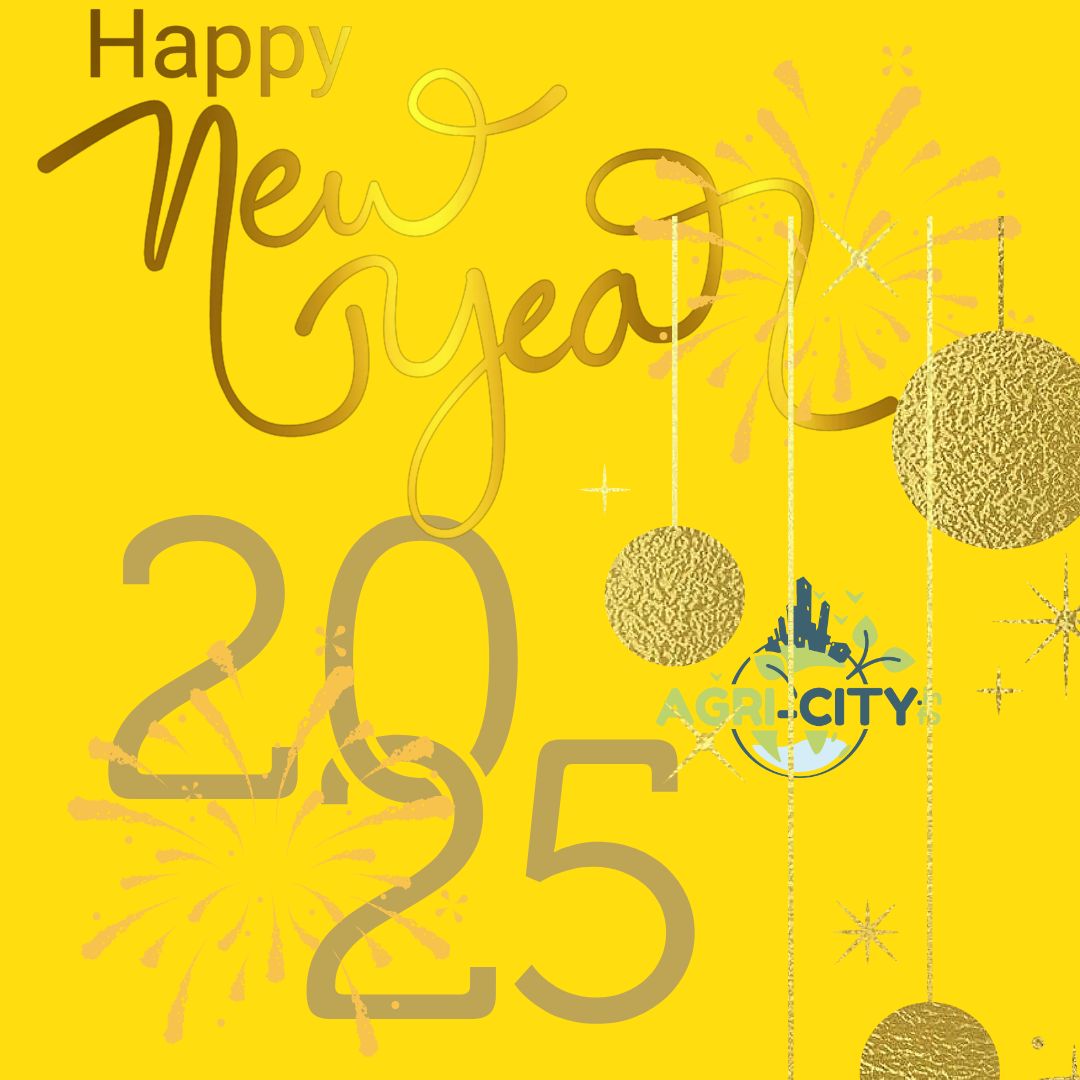MicroAgri : un cadre de définition des micro-fermes
Les travaux de Damien Toublanc insèrent les micro-fermes dans une perspective large, sociologique et économique, en proposant un état de la connaissance sur les petites agricultures. Cespetites fermes ont "un rôle à jouer dans la transition agroécologique"
Damien, qu'est-ce qui vous a poussé à approfondir le sujet des microfermes, sous un angle nouveau ?
Je suis entré sur le sujet des micro-fermes il y a 10 ans, non pas par effet d’opportunisme médiatique (le terme était très peu connu à l’époque, nous parlions d’ailleurs de micro-structures agricoles) mais par une injustice que subissait une agricultrice dont j’étais client sur le marché de Bordeaux. Elle cultivait des PPAM et était harcelée par la MSA, ses voisins, le maire, etc. Cette agricultrice était une « paysanne-herboriste », non issue du territoire, non issue du milieu agricole et ayant de surcroit obtenu ses terres dans une commission SAFER, juste devant le fils du voisin adjoint au maire. Et je ne parle pas des menaces, des cadavres d’animaux et des balles de chasseurs trouvés devant sa porte. L’histoire de ma recherche, mon ancrage il est là, dans cette injustice violente. La science doit pouvoir apporter un regard distancié et des espaces apaisés de dialogue.
Il s'agit donc d'une approche plus sociologique que technique dont vous avez tiré le sujet de vos recherches?
Je m’inscris dans les courants scientifiques français et anglophones de légitimation qui sont au plus près du « terrain » pour co-construire une compréhension située des problèmes sociaux, et surtout d’un même geste, tenter de les résoudre. Étymologiquement, la « com-préhension », c’est « saisir ensemble » !
Nous avons co-construit un programme avec des chercheur-euse-s, acteur-rice-s de l’installation (ADEAR, GAB, TDL, Chambre d’agriculture) et agriculteur-rice-s. Pendant 3 ans, nous avons travaillé à la définition, la caractérisation et l’évaluation des micro-fermes. Au milieu du programme, j’ai bâti un sujet de thèse pour lequel j’ai obtenu des financements de la Région Nouvelle-Aquitaine, du Département de la Gironde, de Bordeaux Métropole et de la Fondation Au Nom de Sélène sous égide de la Fondation Terre de Liens. Elle fut co-dirigée par Mayté Banzo, professeure de géographie à l’Université Bordeaux Montaigne (UMR Passages – CNRS) et Bernard Delhomme, maître de conférences en gestion à Bordeaux Sciences Agro (UMR ETTIS – INRAE).
Quelles sont vos principales conclusions et que mettez-vous particulièrement en avant ?
D’abord, mes travaux insèrent les micro-fermes dans une perspective plus large en proposant un état de la connaissance sur les petites agricultures. En dépit de leur disqualification par les politiques publiques (invisibilisation, manque de soutien et de reconnaissance), les petites fermes ont encore un rôle - et sans doute davantage - à jouer dans la transition agroécologique forte. Ensuite, combinant l’exploitation secondaire des résultats de MicroAgri, l’étude des 99 fermes spécifiquement étudiées dans mon terrain de thèse et l’analyse de la Presse Quotidienne Régionale publiée depuis la fin des années 1990, je confirme que les micro-fermes dépassent la définition proposée par Kevin Morel dans sa thèse (2016) et celles instruites par les chercheur-euse-s travaillant sur l’agriculture urbaine. Les micro-fermes ne sont pas (seulement) une catégorie de fermes urbaines.
Je marque cette ouverture dans mon vocabulaire en incitant à les étudier par la notion de « monde social » .
Vous avez défini un nouveau cadre pour ces microfermes?
Grâce à des allers-retours avec le terrain, MicroAgri a permis de co-construire un cadre de définition des micro-fermes qui ouvre à une diversité d’ateliers (pas uniquement maraîcher) et de dimensionnement des facteurs de production (on sort du critère discriminant de la surface).
Une ferme qui s’inscrit plus ou moins dans ces 5 objectifs est identifiée comme une micro-ferme : exercer une activité agricole, professionnelle, diversifiée et de petite dimension, - réaliser un projet de vie, tendre vers l’autonomie, s’inscrire dans le territoire et œuvrer pour l’agroécosystème
Cette définition a été pensée dans une perspective de développement d’une méthode d’identification et d’évaluation. Chaque « objectif » ou « principe » se décline en « sous-modalités ».
La compréhension de la diversité et la complexité de ce que sont les micro-fermes révèlent plus largement l’existence d’un « mode ou style de vie » conjuguant projet professionnel et privée, engagement pour l’agroécologie forte, insertion territoriale. Je mobilise particulièrement l’outil de la « médiation territoriale » proposée par le géographe Christophe Albaladejo dans le cadre de son instruction de la théorie des pactes territoriaux . Un autre outil est mobilisé en complément : la notion de « modèle agricole et alimentaire ». Elle permet de construire une compréhension du phénomène à travers les « aspirations/revendications » (modèle-futur désiré), la « récurrence des pratiques » (modèle-archétype) et les « normes pour l’action » (modèle-norme) promues par les acteur-rice-s de ce monde social.
Le lien avec le territoire semble donc essentiel ?
Nous révélons que le territoire joue en effet un rôle majeur dans la viabilité de ce type de ferme justement parce que ces fermes se construisent, vivent et évoluent à travers lui. À rebours des références technico-économiques, nous proposons une lecture territoriale de la viabilité de ces fermes. Et la petite dimension ou plutôt, la dimension « proportionnée » de chacun de ces systèmes d’activité tient son importance dans le subtil équilibre qu’ils expérimentent.
Davantage qu’une « simple » émergence, le nouvel essor des petites fermes concrétise une forme de résurgence des mouvements socio-politiques alternatifs (datés pour certains de plus d’un siècle). À l’opposé de la concentration, la spécialisation et l’industrialisation que suit une partie de l’agriculture française, cet ancrage socio-politique et les perspectives proposées par ce modèle façonnent déjà sur nos territoires une nouvelle société écologique et solidaire. En somme, un nouveau pacte territorial entre agriculture, alimentation et citoyen(ne)s est en train de voir le jour.
Nos travaux amènent donc à repenser les modes de soutiens publiques comme celui de la PAC, principalement orientée vers l’agriculture dominante.
Au contraire, la mise en place d’un nouveau pacte territorial « convivial » doit passer par la multiplication et la coordination de nombreuses démarches agricoles et alimentaires locales (traduites ou non politiquement). La transition agroécologique paysanne s’accomplira par ces nouveaux ancrages démocratiques.
Damien est docteur en géographie au laboratoire Passages à Bordeaux (CNRS – Université Bordeaux Montaigne). Après msn diplôme d’ingénieur agronome spécialisé dans l’analyse des agro-écosystèmes (diplômé de Bordeaux Sciences Agro), il a connu deux expériences professionnelles spécifiques. Il a été cartographe à la DRAAF puis contrôleurs des élevages à l’ASP. Il a co-fondé et coordonné,en tant qu’ingénieur de recherche au CNRS de Bordeaux le programme de recherche-action MicroAgri (2017-2020).