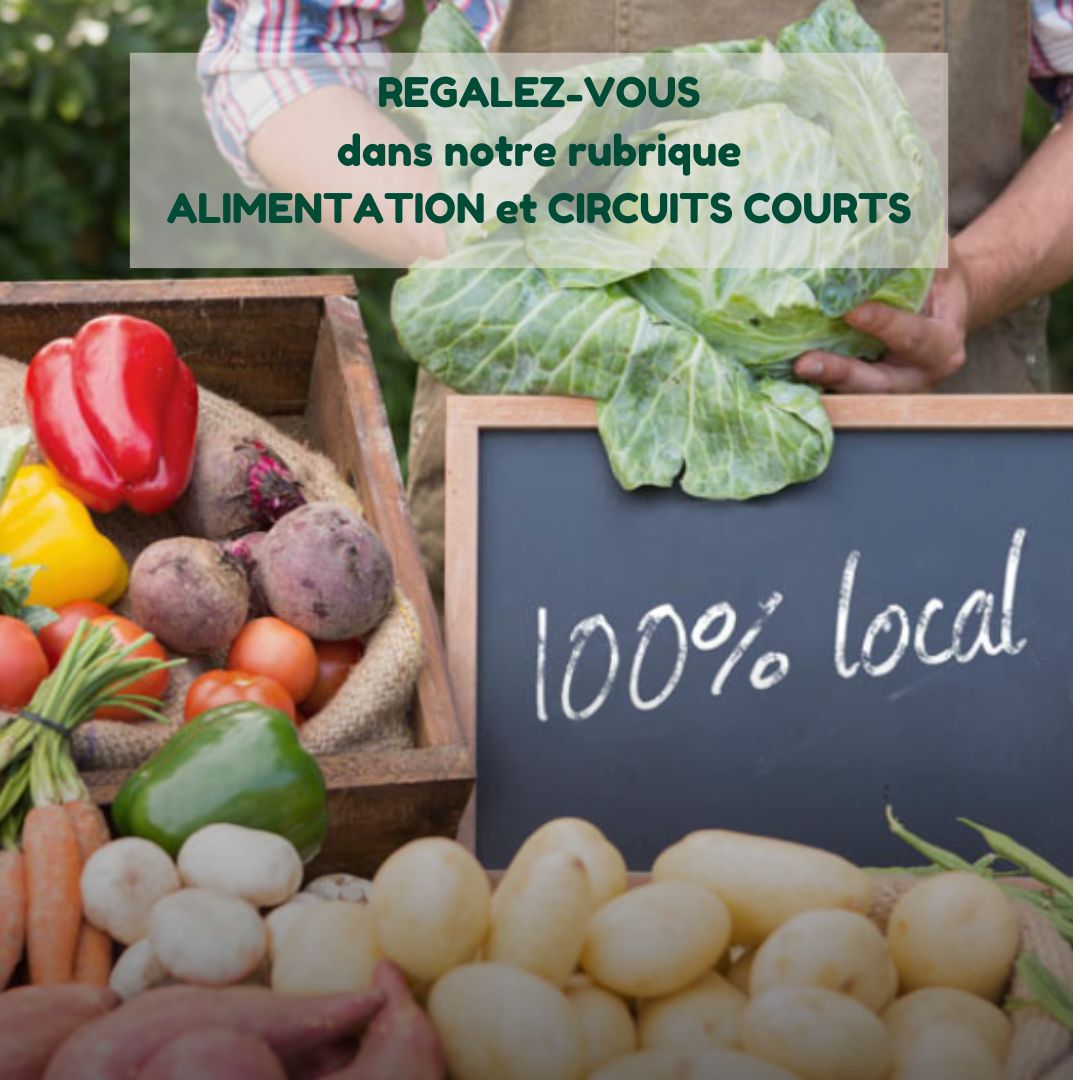Peut-on "restaurer" la nature ?
 Projet de restauration dans les zones humides du marais d'Alviso, refuge faunique Don Edwards, sud de la baie de San Francisco, Californie. Sundry Photography/Shutterstock
Projet de restauration dans les zones humides du marais d'Alviso, refuge faunique Don Edwards, sud de la baie de San Francisco, Californie. Sundry Photography/Shutterstock
Une proposition de règlement a été adoptée à une très courte majorité, le 11 juillet 2023, après un parcours législatif particulièrement houleux au sein de la Commission agriculture. L’essentiel des débats a porté sur le périmètre de ce règlement (dont les terres agricoles ont finalement été exclues) ainsi que sur le niveau de contrainte qu’elle exerce sur les États membres. Analyse d'experts avec The Conversation France*.
En juillet 2023, au comble de la torpeur estivale, une question brûlante échauffait l’hémicycle du Parlement européen. L’Europe en fait-elle assez pour protéger l’environnement ? Au-delà de la protection de la nature, ne faudrait-il pas s’engager un cran plus loin, proactivement, à la « restaurer » ? Cette idée était au centre de la proposition de règlement adoptée l'été dernier.
Pour les résumer succinctement, les débats mettaient en scène l’habituelle opposition entre la protection de l’environnement, plutôt soutenue à gauche et par les verts, et la protection de l’économie et des activités agricoles, plutôt soutenue à droite et, en particulier, par le Parti populaire européen.
Un constat unanime
Si personne n’était d’accord sur la réponse à apporter, le constat de départ fait consensus. Il est celui d’une perte considérable de biodiversité et d’une incapacité à endiguer la déplétion des écosystèmes terrestres et marins. Ce constat, établi par un rapport de l’Agence européenne de l’environnement, désigne les facteurs responsables de cette situation : l’emprise toujours croissante du bâti, des modèles agricoles très intensifs mais encore et surtout une incapacité du cadre réglementaire actuel à produire des effets concrets. Ce diagnostic a conduit la Commission à faire de la restauration de la nature un enjeu politique majeur de son Pacte vert, en renforçant le caractère contraignant des mesures.
Restaurer à l’identique ou réinterpréter la nature ?
Pourtant, cette idée ne va pas de soi, et la question mérite d’être posée : peut-on seulement « restaurer » la nature ? Le terme de restauration suggère un retour, sinon à un état initial, du moins à un état antérieur. Dès lors, comment déterminer quel état antérieur fait référence ? Faut-il revenir à la situation qui existait il y a 10, 20, 50 ou 100 ans ? Et comment caractériser l’état auquel il faudrait revenir ? Parmi les innombrables espèces végétales et animales peuplant les sites concernés, lesquelles seront prises en compte dans une démarche de restauration de l’écosystème ? Comment établir la liste des entités qui ont souffert (sols, animaux, humains, rivières, végétation, etc.) ? Comment faire le tri entre ce qui compte et ce qui sera négligé ? En pratique, les réponses à de telles questions dépendent toujours de circonstances situées.
Ce type d’exploitation consiste à creuser le lit argileux d’un cours d’eau pour en extraire de l’or, ce qui implique nécessairement de détruire une zone de forêt et de détourner un cours d’eau. La fine couche de sol fertile est rapidement dispersée par les pluies, laissant à nu un sol stérile et en proie à une érosion rapide. Depuis les années 2000, les exploitants ont l’obligation légale de réhabiliter et de revégétaliser les sites miniers. Il est notamment attendu des opérateurs miniers qu’ils effectuent des travaux de terrassement afin de reboucher les trous qu’ils ont creusés et de recréer les méandres de la rivière, et qu’ils replantent des arbres sur au moins 30 % de la surface déboisée. Mais, en pratique, un flou persiste sur les critères permettant de juger si les travaux de réhabilitation et de revégétalisation sont satisfaisants, afin de libérer (ou non) l’exploitant minier de ses obligations.
Agents de l’ONF (office national des forêts), experts travaillant dans des bureaux d’étude, chercheurs et fonctionnaires de l’administration impliqués dans les processus de reforestation se penchent sur le problème et y apportent des réponses différentes. Certains acteurs insistent sur le rétablissement d’un couvert végétal sur le sol déboisé, d’autres sur le retour d’une activité microbienne dans le sol, d’autres encore sur la présence d’arbres « charismatiques », endémiques de la Guyane. Quant à la rivière, certains acteurs insistent sur un reprofilage du cours d’eau fidèle aux tracés d’origine, quand d’autres préfèrent des méthodes qui portent moins sur la reconstruction d’un paysage que sur le retour de la vie aquatique.
Les limites de la restauration
Dans un contexte de ressources techniques et financières limitées – les entreprises impliquées dans l’exploitation de l’or alluvionnaire, souvent décrites comme « artisanales », opèrent avec relativement peu de moyens – il est difficile de mettre en pratique ces diverses exigences. Pour prendre la mesure de ces limites techniques et financières, on peut citer par exemple le cas de très petites entreprises travaillant avec une ou deux pelles mécaniques et qui jugent trop chers les services des bureaux d’étude spécialisés dans les travaux de réhabilitation et de revégétalisation. Dans ces cas-là, les travaux de réhabilitation sont conduits en interne, par les mêmes ouvriers qui ont creusé le flat alluvionnaire. Une autre difficulté souvent évoquée est liée à l’approvisionnement en graines ou en plants en grande quantité, au vu du petit nombre de pépinières spécialisées dans la revégétalisation des sites endommagés par l’activité minière.
C’est en particulier un problème pour des groupes humains autochtones dont les modes de vie et de subsistance sont étroitement liés au milieu. Des politiques fondées sur une telle vision de la nature peuvent par exemple conduire à exclure certaines activités humaines (chasse, pêche, cueillette), en favoriser d’autres (tourisme vert) et ainsi définir de bons et mauvais usages d’un milieu naturel. Par ailleurs, les paysages pensés comme naturels sont souvent le résultat d’interventions humaines et portent donc la trace d’événements et d’organisations sociales et politiques passés, impliquant souvent de multiples oppressions. Ainsi, la forêt tropicale guyanaise est un espace qui ne peut être envisagé comme « vierge » et vide d’humains que parce que l’arrivée des colons européens a provoqué, par la violence et la propagation de maladies, une chute tristement spectaculaire de la population autochtone qui la peuplait.
On le voit, au travers de situations concrètes faites de contraintes financières, d’incertitudes scientifiques et de difficultés techniques, l’ambition de restaurer la nature se traduit par un geste partiel et partial, qui suppose une réinvention et une réinterprétation a minima d’un milieu naturel plutôt qu’un retour à l’identique. Les acteurs impliqués dans le contrôle des travaux de réhabilitation des zones endommagées par l’exploitation minière ont d’ailleurs cessé d’employer le terme de restauration, estimant qu’un retour à l’identique des sites est impossible, et que la destruction causée par les mines d’or est en partie irrémédiable.
Remédiation plutôt que restauration
En plus d’idéaliser le passé, la notion de « restauration » dépolitise le futur. En effet, l’idée qu’une restauration de la nature est possible peut se révéler délétère si elle est employée pour justifier de nouveaux projets impliquant des dommages environnementaux. Nous proposons de mettre en avant la notion de remédiation écologique.
D’abord, remédier signifie apporter un remède : ce terme insiste sur le dommage causé et rappelle ainsi l’existence d’une situation problématique nécessitant de l’attention et du soin. Plutôt qu’un retour en arrière ou à l’identique, la « remédiation » évoque un processus de transformation à l’issue incertaine, qui laisse visibles non seulement les traces des destructions écologiques passées, mais aussi les traces des gestes de réparation accomplis sur un milieu. En effet, certaines opérations de remédiation peuvent échouer tout à fait, ou ne réussir que partiellement. Dans le cas de la forêt guyanaise par exemple, les arbres replantés sur les sites miniers ne survivent pas toujours sur un sol stérile, ou bien forment un couvert végétal qui améliore la situation en limitant l’érosion sans pour autant évoluer vers un retour de la forêt tropicale.
Plutôt que de revenir à un passé figé, la notion de remédiation invite à fabriquer de nouvelles médiations écologiques, et donc à poser explicitement la question inévitable de ce qui est considéré comme important et précieux dans une situation donnée. En d’autres termes, elle rend visibles et débattable les choix qui doivent être faits. En effet, les différentes options techniques favorisent différents types d’êtres (arbres, animaux, micro-organismes, etc.) en organisant des conditions propices à leur implantation à partir de la situation de dégât écologique.
Au-delà de la question sémantique, le choix d’un terme pour décrire des opérations de réparation de la nature implique différents rapports à la nature, aux torts qui ont été causés aux milieux et aux façons d’y répondre. Ainsi, « restaurer » naturalise un état auquel il faudrait revenir alors que « remédier » implique de fabriquer de nouvelles médiations tout en faisant exister, de façon pratique, le fait même que ces relations aient été endommagées en premier lieu – et donc la nécessité de les réparer. En ce sens, le terme de remédiation nous semble mieux indiqué pour tendre vers une réinvention des relations entre humains et non-humains, réunis dans une seule communauté de destin. Finalement, la notion de remédiation écologique offre une ligne de fuite entre une position cynique, postulant que les écosystèmes sont irrémédiablement détruits, et une position prométhéenne utilisant les possibilités de restauration comme argument pour justifier qu’on continue à produire et à exploiter comme avant.