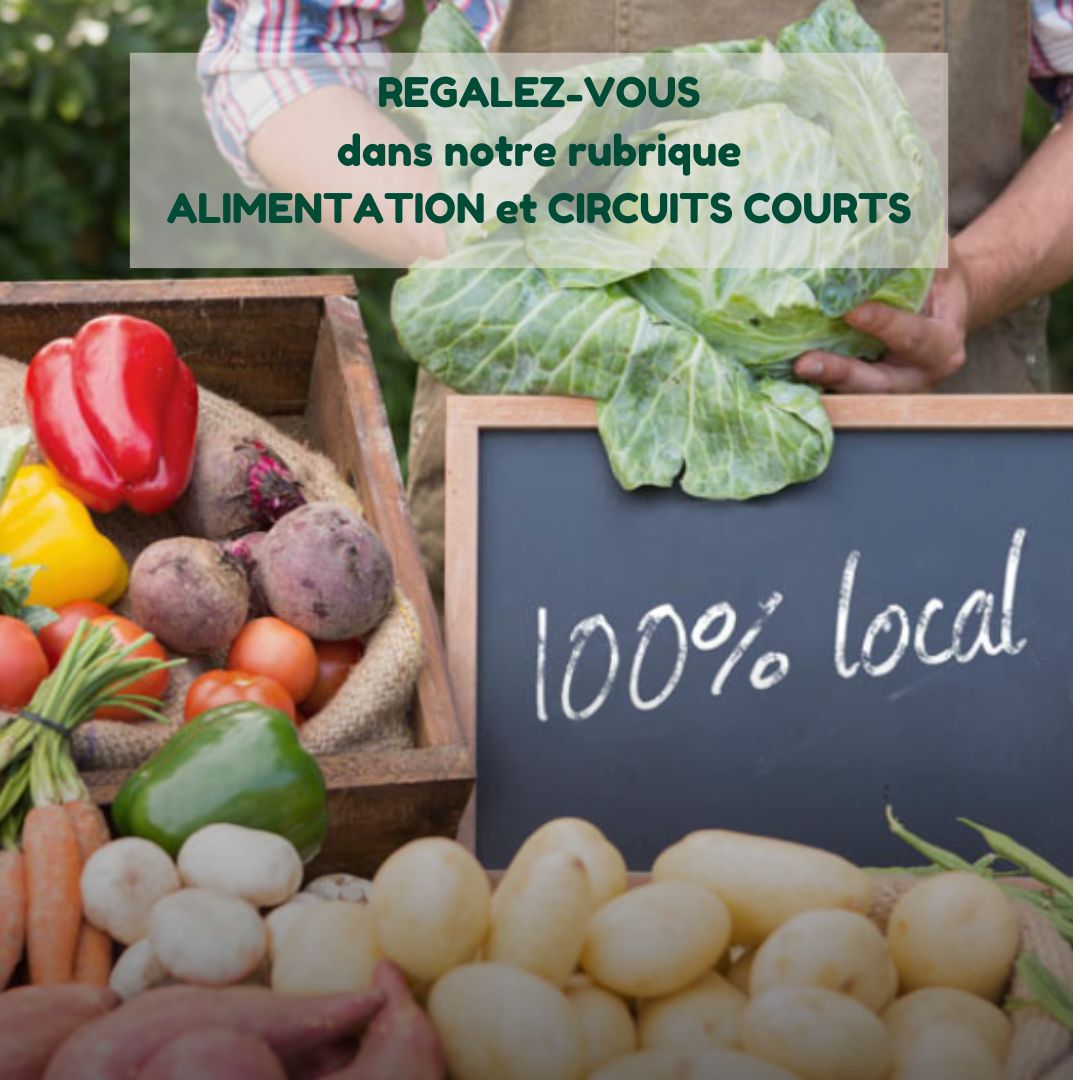Zéro phyto des sols sportifs : 100 % des villes engagées
 Près de 38 % des villes inscrivent leur politique zéro phyto dans une démarche environnementale globale
Près de 38 % des villes inscrivent leur politique zéro phyto dans une démarche environnementale globale
L’Observatoire des villes vertes a mené une enquête auprès des villes sur les pratiques d’entretien de ces équipements et la mise en œuvre du zéro phyto chimique par les villes*. Pivot de la pratique sportive urbaine, l’entretien des infrastructures sportives doit concilier sécurité des usagers, qualité des terrains et respect de l’environnement.
Si toutes les collectivités interrogées (100 %) ont engagé une politique de zéro phyto chimique, leur niveau d’avancement reste contrasté. Près de la moitié (44 %) l’applique depuis plus de cinq ans, signe d’une maturité écologique. Parmi elles, des villes comme Royan, Caen, Pornichet, Metz, Limoges ou Besançon illustrent cette approche de long terme, intégrée dans les pratiques quotidiennes d’entretien. Plus d’un tiers (38 %) des collectivités ont initié leur transition plus récemment, entre deux et cinq ans, traduisant une dynamique en cours d’appropriation.
Près de 38 % des villes inscrivent leur politique zéro phyto dans une démarche environnementale globale comme Angers, Limoges ou Caen, tandis que 31 % l’intègrent directement dans les cahiers des charges d’entretien à l’image de Perros-Guirec ou Pornichet. Un quart dispose d’une charte ou d’un plan d’action local, et 12,5 % valorisent leurs engagements via une labellisation (Terre Saine, EcoJardin, etc.). Cependant, près d’une ville sur cinq (19 %) ne dispose pas encore d’un cadre officiel.
« L’arrêt des produits pesticides n’est plus une question d’intention, mais de structuration. Les collectivités ont franchi le pas, mais elles doivent désormais consolider leurs démarches et mieux les inscrire dans la durée. », commente Anne Marchand, co-présidente de l’Observatoire des villes vertes.
Terrains sportifs : la biodiversité peine encore à trouver sa place face à la performance
En interrogeant les collectivités, l’Observatoire des Villes Vertes constate que la performance des surfaces sportives demeure un enjeu central : il s’agit de garantir des conditions de jeu optimales tout en réduisant l’usage des produits chimiques et des ressources. La gestion de l’eau illustre parfaitement cette préoccupation : identifiée comme une priorité par 94 % des villes, elle mobilise des investissements importants. De nombreuses collectivités, comme Limoges, Angers ou Orléans, ont déployé des systèmes d’arrosage économes ou des dispositifs de récupération des eaux, cherchant ainsi à concilier efficacité et sobriété.
En revanche, les enjeux de biodiversité restent encore marginaux (6 %), révélant un arbitrage toujours orienté vers la performance des équipements plutôt que vers leurs bénéfices écologiques. Cette logique se retrouve dans les outils d’évaluation : 75 % des villes s’appuient sur l’observation visuelle de l’état des terrains et 44 % sur les retours des usagers, tandis que la mesure de la biodiversité demeure quasi absente (2,5 %).
Pour autant, cette recherche de performance n’exclut pas une ouverture croissante à l’innovation. Une collectivité sur deux (50 %) expérimente aujourd’hui des solutions nouvelles — adaptation des hauteurs de coupe, introduction d’espèces végétales plus résilientes, ou recours à des outils connectés pour piloter les interventions.
L’accompagnement, un enjeu clé pour une mise en œuvre réussie
Concernant les principaux défis rencontrés par les collectivités, le maintien de la qualité sportive des terrains arrive en tête. Cet enjeu est suivi par la maîtrise des coûts et l’adaptation des pratiques au changement climatique (62,5 %), deux priorités qui traduisent la volonté des villes de concilier exigence sportive, résilience et soutenabilité économique.
Pour y répondre, les collectivités ne réclament pas d’abord des financements, mais avant tout des moyens humains et techniques. Elles expriment une forte attente en matière de formation (62,5 %) et d’expertise spécialisée (56 %), confirmant que les obstacles à la transition sont plus liés à la montée en compétences et à l’opérationnalité qu’à un manque de ressources budgétaires.
« La transition écologique des terrains sportifs ne se résume pas à un changement de pratiques, mais à une évolution de culture. Elle s’appuie sur la montée en compétences des équipes et sur l’expertise des entreprises du paysage, qui permettent aux collectivités de passer d’une logique d’entretien à une véritable gestion durable du vivant. » conclut Laurent Bizot, co-président de l’Observatoire des villes vertes.
19 % des villes n’ont pas encore formalisé leur politique zéro phyto chimique
94 % des villes font de la gestion de l’eau un enjeu prioritaire, mais seulement 6 % citent la biodiversité
62,5 % des collectivités expriment un besoin de formation et 56 % un besoin d’expertise technique
*Méthodologie : Réponses récoltées auprès d’un panel de villes sollicitées entre le 23 septembre et le 24 octobre 2025. Sur cette période, 16 collectivités ont répondu à cette vague d’enquête de l’Observatoire des villes vertes.