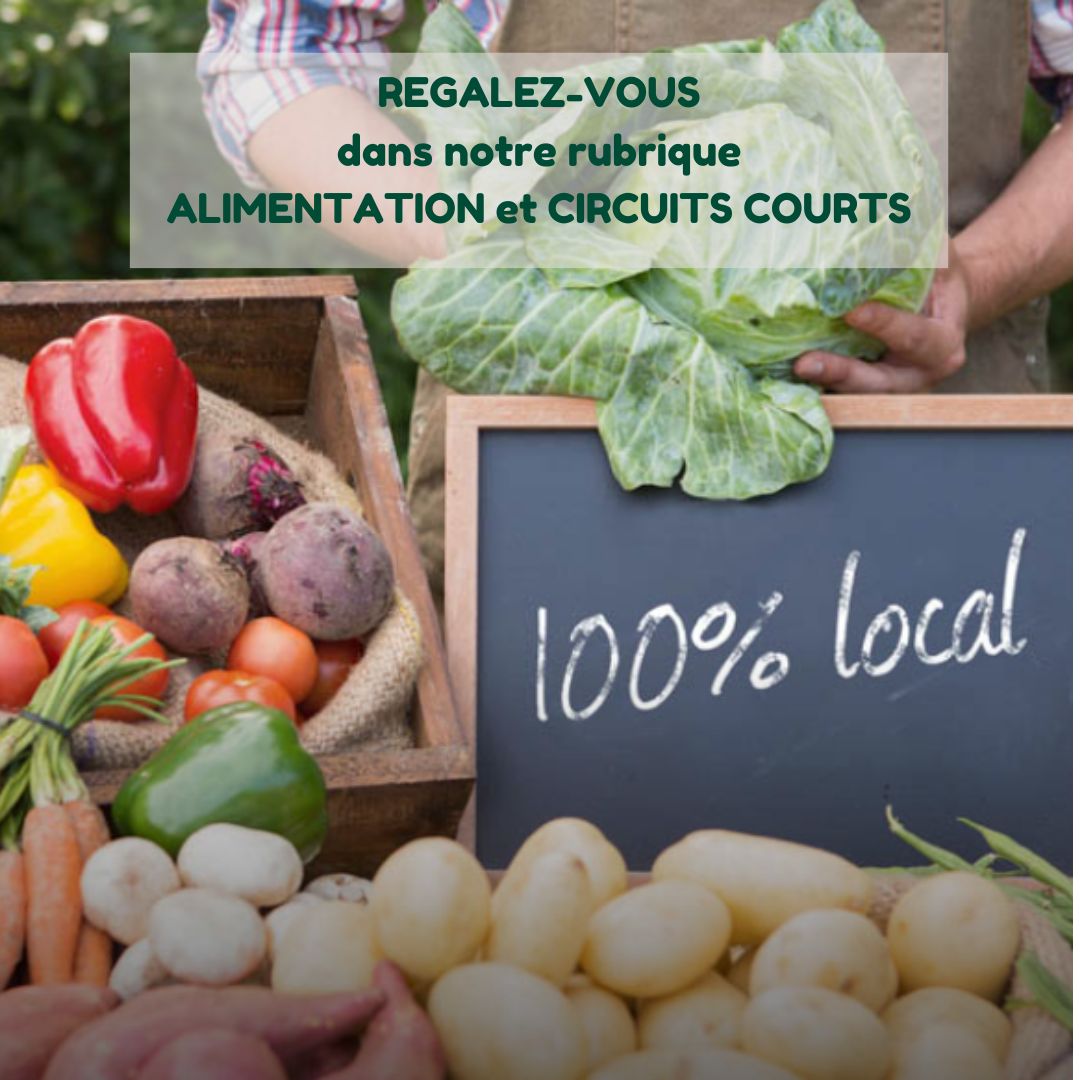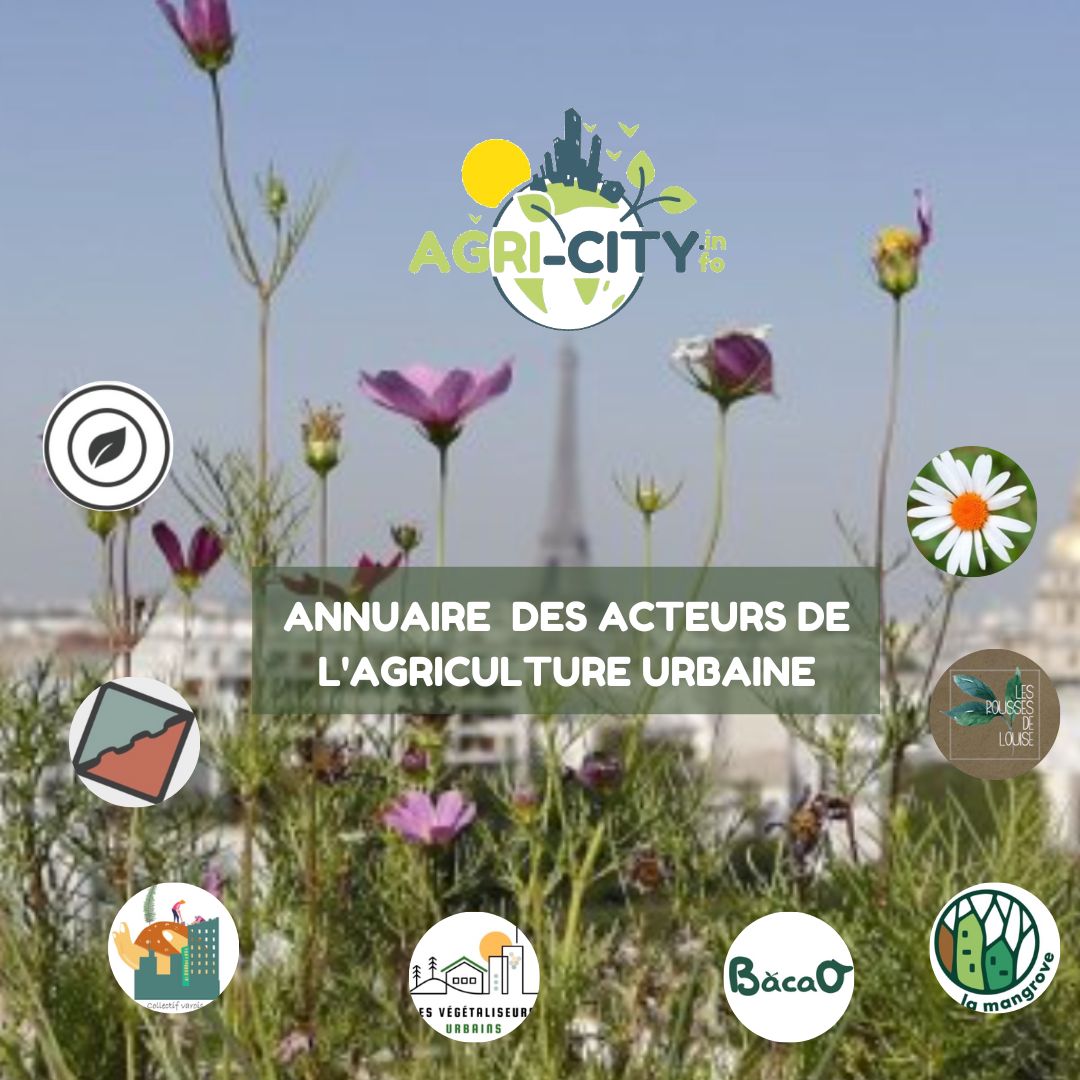Les jardins familiaux ouvrent la voie de nouvelles manières de cultiver la ville
L’agriculture urbaine, sous sa forme la plus traditionnelle n’est pas nouvelle. Ses débuts remonteraient à 1896, date à laquelle l’abbé Jules Lemire crée la Ligue Française du Coin de Terre et du Foyer dont l’objectif est de mettre à disposition un coin de terre pour y cultiver des légumes. Les Parisculteurs en particulier ont relancé le concept, dès 2016. Explications.
 Avec l’appel à projets initié par la ville de Paris il y a 10 ans, l’agriculture urbaine a fait parler d’elle, et des collectivités territoriales à différentes échelles s’emparent de la thématique, très séduisante pour les citoyens et les habitants des villes, en particulier. Une bouffée d’air des campagnes s’élève vers les villes.
Avec l’appel à projets initié par la ville de Paris il y a 10 ans, l’agriculture urbaine a fait parler d’elle, et des collectivités territoriales à différentes échelles s’emparent de la thématique, très séduisante pour les citoyens et les habitants des villes, en particulier. Une bouffée d’air des campagnes s’élève vers les villes.
L’autre étape importante en France, a été le lancement du programme Quartiers Fertiles avec l’Agence Nationale de la Rénovation Urbaine (ANRU) début 2020. Il vise à développer l’agriculture urbaine dans les quartiers prioritaires de la ville en rénovation.
Les jardins familiaux
En 1952 en France le terme de « jardins familiaux » rentre dans le code rural. Ces jardins familiaux connaitront une certaine désaffection pendant les Trente Glorieuses. En France, depuis la reconnaissance nationale des jardins familiaux, l’action en faveur de l’agriculture urbaine a été très majoritairement portée par des collectivités territoriales et des associations citoyennes.
Poids des associations
A partir de 1997, on assiste à une première rencontre du monde associatif et des particuliers déjà engagés dans la création d’espaces de jardinage dit « partagé ». L’objectif principal étant d’échanger sur leurs expériences et d’élaborer une première charte commune de valeurs et des principes d’action. A l’échelle locale, se créent des associations pouvant accompagner la mise en place de jardins partagés, comme Graines de Jardins en Ile de France ou Vert le Jardin, en Bretagne, par exemple. Certaines villes mettent en place des programmes publics de jardinage collectif.
L’agriculture urbaine véhicule des valeurs fortes autour du respect de l’environnement, de partage et d’économie sociale et solidaire, même si des formes commerciales et des structures high tech se développent parallèlement aux jardins partagés. Ce qui crée un écosystème très vaste, encore assez diffus et disparate.
Les jardins familiaux ont toujours été gérés par des associations. En 1896, il s'agissait de la Ligue Française du Coin de Terre et du Foyer qui s'est transformée en Fédération Nationale des Jardins Familiaux (FNJ.F) qui deviendra en 2006, la Fédération Nationale des Jardins familiaux et Collectifs (FNJFC). Aujourd'hui, près de 135 000 adhérents sont fédérés par le Conseil national des jardins collectifs et familiaux (CNJCF) né à l’initiative conjointe de la Fédération Nationale des Jardins Familiaux, de Jardinot (le jardin du cheminot) et de la Société Nationale d’Horticulture de France (SNHF).
(encadré facultatif ) 1970-2000 : le mouvement de Green Guerillas et des jardins partagés
Dans la décennie 1970, à New York City, émerge le mouvement des « Green Guerillas » mené par Liz Christy qui visait à reconquérir des espaces urbains en friches et abandonnés pour créer des espaces verts accessibles à tous. Au fil des ans, ce mouvement s’est propagé dans le monde entier en revendiquant des formes d’appropriation de l’espace et d’amélioration du cadre de vie, notamment par le jardinage collectif.
C’est en 1896 que l’abbé Jules Lemire , député du Nord veut donner l’opportunité au chef de famille ouvrier d’avoir accès à un lopin de terre pour contribuer à l’alimentation de sa famille. En 1916, la Ligue que l’ecclésiaste a créé est chargée par le Ministère de l’Agriculture de distribuer une subvention d’Etat destinée à la création de jardins pour répondre aux problèmes d’approvisionnement liés au conflit mondial. Les pouvoirs publics vont à nouveau faire appel à la même organisation dans les années 39-45 pour développer des jardins potagers indispensables pour l’approvisionnement alimentaire en temps de guerre. Dans d’autres pays, les jardins collectifs sont également soutenus, notamment en Amérique du Nord ou en Italie.